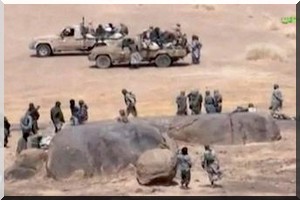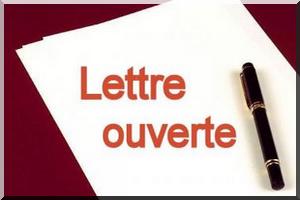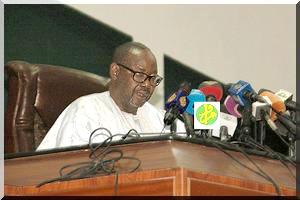En janvier 2013, la bataille de
Konna avait porté un coup d'arrêt à l'expansion des groupes jihadistes au nord du Mali.
Laurent Touchard* revient en détail sur cet épisode qui a vu l'entrée en guerre des Français avec l
'opération Servalmais aussi une résistance courageuse des forces maliennes.
*
Laurent Touchard travaille depuis de nombreuses années sur le terrorisme et l'histoire militaire. Il a collaboré à plusieurs ouvrages et certains de ses travaux sont utilisés par l
'université Johns-Hopkins, aux
États-Unis.Dans le document que
Blaise Compaoré reçoit des représentants d
'Ansar Eddine, le 1er janvier 2013, figurent deux points principaux. Tout d'abord, l'organisation radicale demande que
"le caractère islamique de l'État du Mali soit proclamé solennellement dans la Constitution." Ensuite, si l'idée de l'indépendance du nord n'est plus envisagée à court terme, est mentionnée celle d'une autonomie de l'
Azawad. Bien entendu
Bamakorefuse ;
Iyad Ag Ghaly annonce alors que son offre de cessation des hostilités est désormais caduque.
Dans la foulée, il amasse des forces de plus en plus nombreuses au nord de la ligne de démarcation entre le nord et le sud
Mali, encouragé par l'absence de réaction de la communauté internationale et surtout, de la
France. Les 4x4 sont chargés de bidons de carburant, d'eau, de vivres, de munitions. Bientôt, il ne fait plus aucun doute que les combattants d'
Ansar Eddine vont en découdre...
Cette offensive creusera la tombe des capacités militaires
"conventionnelles"d'
Ansar Eddine, du
Mujao et des katibas d'
Aqmi dans la région. Elle apportera aussi la preuve – une fois encore - que la fragile armée malienne dispose de militaires de valeur en dépit de terribles lacunes.
Les forces en présenceLe 7 janvier, les dissidents se regroupent tout d'abord à
Bambara Maoudé, à environ 210 kilomètres à vol d'oiseau au nord est de
Mopti (287 kilomètres par la route). Puis ils se rapprochent, établissant une zone de desserrement à
Boré, à 101 kilomètres au nord est de
Mopti (124 par la route). Or, sur le trajet qui conduit de
Boré à
Mopti, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest, il y a la localité de
Konna. Celle-ci bloque donc l'itinéraire qui conduit à la base de
Sévaré, près de
Mopti. Ce d'autant plus qu'à l'ouest de
Konna, il y a le fleuve Niger. La coupure humide souligne le chemin entre les deux villes tout en barrant l'espace géographique à l'ouest. Le fleuve compartimente donc le terrain en une sorte de couloir qui conduit à
Mopti. Mopti, c'est aussi la porte vers le sud.
Sévaré en est le verrou,
Konna le trou de serrure...
En tout, 1 500 à 2 500 combattants islamistes se concentrent en quelques jours au nord de la ligne de démarcation, avec jusqu'à 300 pick-ups dont beaucoup sont armés. Il ne s'agit que d'une partie de leurs forces, à savoir les plus mobiles, les mieux équipées et les plus aguerries. Les autres, les
"auxiliaires" recrutés à coups de dollars, les volontaires plus opportunistes que fanatiques ; milices peu solides qui contrôlent les villes pour empêcher toutes rebuffades des populations, elles s'évanouiront dans la nature à la première occasion.
Ces rebelles sont bien armés comme nous l'expliquions dans un article avant l'opération Serval. Cependant, leur matériel est loin d'être aussi sophistiqué que d'aucuns l'affirment à l'envi.
Face à eux, le colonel
Didier Dacko qui commande le dispositif opérationnel malien, est en mesure d'aligner des unités avec des hommes motivés. C'est d'ailleurs leur seul véritable atout. Ces unités comprennent le
Groupement des Commandos Volontaires (GCV) du commandant
Abass Dembélé, le 62e Régiment d'Infanterie Motorisée, ainsi que des éléments du 35e Régiment Blindé et du 36e Régiment d'Artillerie à quoi s'additionnent ce qui subsiste des troupes de la 1ère Région Militaire désormais occupée par l'ennemi.
>> Lire aussi :
le difficile inventaire de l'armée maliennePremiers accrochagesEn théorie, les négociations entre l'État malien et les islamistes doivent reprendre à
Ouagadougou soixante-douze heures plus tard, le 10 janvier 2013. En théorie seulement. Dans la nuit du 7 au 08, des tirs de sommations maliens expliquent aux islamistes qu'ils seraint bien avisés de stopper leur progression en direction de la ligne de démarcation. Ceux-ci semblent comprendre le message et s'arrêtent.
En réalité, ils ne renoncent pas : ils se déploient. Le 8 janvier, à 18 heures,
Ansar Eddine entreprend d'harceler les positions malienne à coups de roquettes de 122 mm, d'obus de canons sans-recul. Les échanges de tir se prolongent jusqu'à une heure du matin. Contrairement à ce qu'espéraient certainement les insurgés, les gouvernementaux ne se débandent pas à la première escarmouche.
Le 9 janvier, le lieutenant-colonel
Mamadou Samaké veut en savoir davantage sur le dispositif qui se met en place, et ainsi, mieux appréhender les intentions de l'ennemi. En fin de journée, il lance donc une reconnaissance offensive qui s'organise autour d'une dizaine de blindés légers
BRDM-2 et d'éléments du 62e Régiment. Il commande personnellement l'ensemble. Aucun contact n'a lieu durant la mission. La colonne fait donc demi-tour : retour sur
Konna. Les combattants d'
Ansar Eddine se dévoilent alors. Tandis qu'un groupe mène l'embuscade contre l'élément mobile totalement surpris, un autre fonce en direction de
Konna. Cavalcade sur KonnaCe groupe assaille la localité de trois côtés, à partir de 8 heures 30 : au nord, par la route de
Korientzé, à l'est par la route de
Douentza et plus au sud afin de couper la retraite de la garnison. Tout en l'isolant d'éventuels renforts.
Peu après, à
Bamako notamment, va courir la rumeur que des combattants islamistes se sont infiltrés, déguisés en civils, à bord d'un bus de la société de transport
Sonef. Il n'en est rien : l'agresseur déboule alors que l'identité des passagers du bus - de véritables civils - est en cours de vérification. Le bus en question est d'ailleurs pris pour cible par les hommes d'
Iyad Ag Ghaly. Cet incident témoigne de la confusion qui règne dans le pays.
À ce moment, les forces gouvernementales sont dispersées, les ordres n'arrivent pas, la cohésion s'émiette, les munitions s'épuisent trop vite, la logistique est déplorable. En outre, les islamistes d'
Ansar Eddine et leurs alliés jihadistes d'
Aqmi et du
Mujao interceptent les messages radios pour connaître les mouvements et positions des militaires maliens qui ne s'astreignent que peu ou prou aux règles élémentaires de sécurité dans les transmissions. Les compte-rendu remontent mal - voire pas du tout - aux chefs qui n'ont qu'une vue partielle - voire fausse - de la situation...
Tactiquement, les combattants islamistes s'imposent. À découvert, ils vont vite, ils manœuvrent. Dans
Konna, ils sautent de leurs 4x4. Appuyés par les mitrailleuses lourdes montés sur leurs véhicules, ils pénètrent dans les habitations, prennent position sur les toits et, de là, au milieu des civils, allument les gouvernementaux qui ripostent tant bien que mal, sans forcément savoir où sont postés ceux qui s'infiltrent si habilement et qui, ensuite, les canardent à la Kalachnikov, au
PKM et au
RPG-7.Pour ne rien arranger, les militaires qui composent la garnison sont convaincus que l'élément mobile a été anéanti. Même s'ils se trompent à ce sujet, l'issue de la bataille est prévisible... La défaite semble de plus en plus inévitable, mais des soldats et des gardes nationaux résistent avec courage, bien que dominé par la maîtrise tactique et la puissance de feu de l'ennemi.
Cependant, les actes de bravoure ne suffisent pas à rétablir une situation désormais catastrophique. Vers 10 heures, les islamistes sont solidement implantés dans
Konna ; les militaires n'ont plus les moyens de les en déloger. Aux environs de 11 heures, les troupes qui composent la garnison entament leur repli. Les combats se poursuivent jusque vers 16 heures, en particulier contre les rebelles qui ont débordé au sud. A 17 heures, l'affaire est dans le sac pour les islamistes : leurs pick-ups roulent dans la ville dont ils sont maîtres.
De son côté, la colonne mobile réussit finalement à rompre le contact. Cadres et soldats savent maintenant que
Konna est tombée. Ils n'ont plus de munitions et, de toute manière, leur infériorité numérique criante les empêche d'envisager une contre attaque efficace. Judicieusement,
Samaké ordonne le repli. Il faut rejoindre le reste des forces qui a évacué la ville.
Désormais, la priorité numéro une, la P1, c'est de bloquer les islamistes pour qu'ils n'atteignent pas
Sévaré. Dans le courant de la soirée, vers 20 heures, un communiqué mentionne la reprise de
Konna grâce à l'aviation malienne ; le centre serait sous contrôle gouvernementale tandis que le colonel Gamou et ses forces auraient traversé la frontière du Niger pour reprendre
Gao.En réalité, il s'agit de désinformation, tant pour préserver le moral des Maliens que pour tenter, maladroitement, de semer le trouble dans le camp ennemi. Sans succès. Intervention des hélicoptères Mi-24
Le lendemain, l'Armée de l'Air malienne entre en lice. Deux Mi-24 Hind remis en état au cours des mois précédents décollent de
Bamako et se posent à
Sévaré. De là, ils
"strafent" les islamistes autour de
Konna vers 09 heures. Même aux mains d'un équipage inexpérimenté et avec des tirs imprécis, l'attaque de ces engins, parfois surnommés "chars volants" reste impressionnante. Les combattants d'
Ansar Eddine ne s'attendent pas à leur intervention.
Celle-ci provoque donc quelques pertes et un certain flottement dans leur rang. Mais là encore, cela ne suffit pas à les arrêter : il est désormais clair qu'ils veulent s'emparer de
Sévaré où croît la panique. Le spectre d'une - nouvelle - lourde défaite se profile dans le fracas des rafales de
Douchka qu'accompagnent les murmures de la peur.
Mais, cela ne ressemble toujours pas à la déroute qu'attendent les hommes d'
Ansar Eddine. L'armée malienne, pour faible qu'elle soit, ne s'est pas évaporée dans la nature. Certes, tout le système défensif malien se casse la figure. Cependant, il s'écroule assurément moins vite que ne l'escomptaient les groupes dissidents.
Le colonel
Didier Dacko, qui commande le dispositif malien du secteur fait flèche de tout bois. Les personnels de l'Armée de l'Air de
Sévaré reçoivent l'ordre de se préparer à combattre en tant que fantassins. Les éléments disponibles se déploient face aux axes supposés de l'arrivée des islamistes. Une vingtaine de
BRDM-2 et des hommes du 33e Régiment Para-Commando sont dépêchés de
Bamako et de
Kati. Malheureusement, les combattants d
'Ansar Eddine reçoivent eux aussi des renforts du
Mujao et probablement d
'Aqmi, estimés à environ 500 hommes.
Retournement de situation et reprise de la localitéLe retournement de situation se produit vers 16 heures, avec le vrombissement
"élancé" de moteurs de Gazelle. Elles appartiennent au 4e
Régiment d'Hélicoptères des Forces Spéciales (4e RHFS) : la France est désormais de la partie. Les deux hélicoptères légers, qui volent à très basse altitude, ciblent une colonne de pick-ups au missile antichar
HOT et au canon de 20 mm. Ils détruisent quatre véhicules, contraignant les autres à rebrousser chemin. Le coup d'arrêt a été donné.
Non sans mal : des tirs d'armes légères touchent les deux voilures tournantes. Dans l'une d'elles, le lieutenant
Damien Boiteux est mortellement blessé. Il parvient néanmoins à poser son appareil à Mopti et meurt durant son évacuation. La seconde
Gazelle atterrit en catastrophe non loin de la zone d'engagement ; elle sera détruite peu après. Le bilan est lourd. Mais les rebelles sont stoppés.
>> Lire : la France a-t-elle piégé les jihadistes en janvier 2013 ?Le lendemain, l'armée malienne annonce la reprise de
Konna, ce qui est loin d'être le cas. Dans la nuit du 11 au 12, les
Mirage 2000D frappent à leur tour depuis le
Tchad. Ce 12 janvier, l'armée donne le bilan de 11 soldats morts et de 60 blessés ; bilan en contradiction avec les témoignages des habitants de la ville qui comptent bien davantage de cadavres en uniforme.
L'organisation radicale islamiste évoque quant à elle 25 soldats maliens tués, 11 véhicules et 6
"chars" (en réalité, des BRDM-2 ou BTR-60PB) détruits. Les rebelles n'ont pas non plus été épargnés : plusieurs dizaines de combattants perdent la vie lors des combats contre les
Fama ou sous les raids aériens.
Un des cadres militaires d'
Ansar Eddine, surnommé
"Kojak", périt d'ailleurs dans la fournaise. De nombreux véhicules – dont beaucoup capturés précédemment aux forces maliennes, à l'instar de lance-roquettes multiples
BM-21 – sont également "traités" aux bombes guidées ou aux missiles antichars.
Le 14 janvier, l'ennemi a saisi qu'il ne progressera plus sur l'axe
Konna-Sévaré-Mopti. Il bascule donc son effort sur
Diabaly en lançant une seconde offensive.
Aqmi est en fer de lance de celle-ci, avec la katiba d
'Abou Zeïd. Le 15 janvier, alors que les combats font rage dans la zone de
Diabaly, le ministre de la Défense français annonce que
Konna n'a toujours pas été reconquise, même si les chasseurs-bombardiers et les hélicoptères mènent de nombreuses missions contre des islamistes et jihadistes désormais exsangues.
Le 17 janvier, seuls quelques combattants rebelles sont encore dans la localité. Le lendemain, l'armée malienne peut enfin annoncer – et, cette fois, la nouvelle est vraie – que
Konna est sous contrôle.
De la défaite de Konna à l'avenir des FamaCette offensive, islamistes et jihadistes la lancent en commettant deux erreurs d'appréciation. D'une part, ils n'imaginent pas une opération de guerre déclenchée par la
France. D'autre part, ils sous-estiment la résistance malienne.
Konna tombe effectivement en quelques heures. Toutefois, nous venons de le voir, la défaite des forces maliennes ne se transforme pas en débâcle absolue.
Oui, les capacités des
Fama sont alors mauvaises, le moral souffre des défaites et des zizanies fratricides. Pourtant, des officiers, sous-officiers et soldats, des gardes nationaux démontrent leur patriotisme, leur détermination, leur esprit combatif. Malgré l'adversité, il ne fait aucun doute que beaucoup d'entre eux ont l'étoffe pour devenir d'excellents militaires, tacticiens émérites, expérimentés, responsables, respectueux des droits de l'Homme, intègres, conscients de leurs devoirs. Professionnels.
Cette étoffe demande bien plus qu'un ou deux ans de travail supplémentaire. Cela implique de prolonger le programme de formation de l'
EUTM-Mali bien au-delà de mars 2014. Il importe en effet d'entraîner la totalité de l'armée malienne, tandis que le quatrième bataillon (et en théorie, le dernier) est en cours d'instruction.
Faire de l'institution militaire malienne un corps homogène, débarrassé de son atavisme de
"syndicalisme" qui sied mal à une armée, est un pré-requis au rétablissement progressif de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. La lutte contre la résurgence des trafics et du terrorisme dans le nord passe par le développement économique, par des structures administratives et judiciaires, par l'éducation et la culture. Mais l'approche globale n'exclut pas de disposer de forces de sécurité capables. L'ensemble est complémentaire en un tout qui garantit la paix pour chacun.
Enfin, pour que d'autres batailles de
Konna ne se déroulent plus, il faut aussi réfléchir à très long terme. Il est essentiel de ne pas abandonner les
Famalorsqu'elles auront été formées dans leur entièreté. De songer à ce que sera un
"après-EUTM". Comme dans tout autre domaine, les acquis militaires s'estompent dangereusement vite s'ils ne sont pas entretenus et perfectionnés. À quoi bon former la moitié d'une armée malienne qui, au bout du compte, sera bancale, pour devoir tout recommencer dans dix ans ?
Dans un prochain billet, nous reviendrons sur les forces armées maliennes aujourd'hui...
___________
>> Retrouver tous les articles du
blog défense de Laurent Touchard sur J.A.>> Pour en savoir plus :
consulter le blog "CONOPS" de Laurent TouchardPar
Laurent Touchard